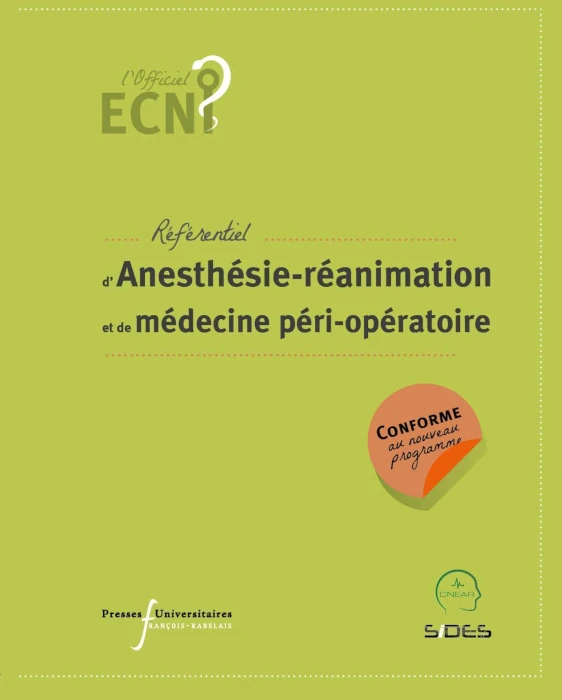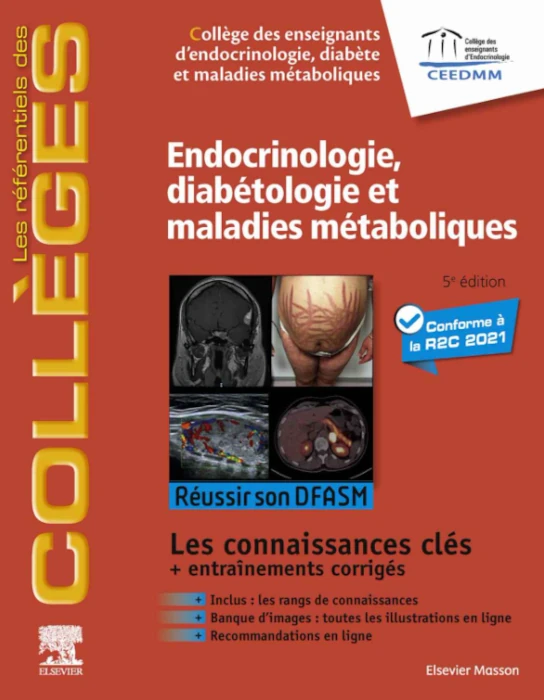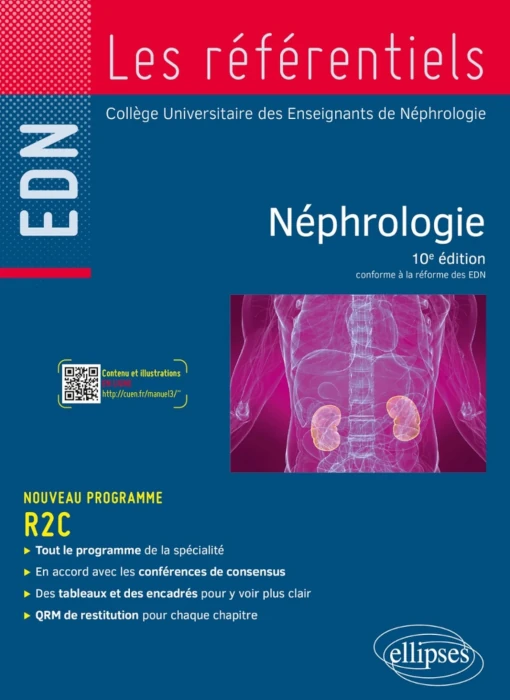Troubles de l'équilibre acidobasique
Rappel de chimie sur le pH
Le terme pH signifie "potentiel hydrogène".
Il s'agit d'une mesure chimique de l'activité des protons (ions hydrogène, H+) dans une solution, permettant d'évaluer son acidité ou sa basicité.
Mathématiquement, cela correspond au logarithme en base 10 de l'inverse de la concentration en ion H+ (ou H3O+):
pH = log (1 / [H+]) = -log [H+]
Ainsi, cette valeur peut varier de 0 à 14.
En chimie, dans une solution acqueuse à 25°C et à la pression atmosphérique, le pH est dit :
- Neutre s'il est égal à 7
- Acide s'il est inférieur à 7
- Basique s'il est supérieur à 7
Dans le corps humain, ce n'est pas tout à fait pareil...
Physiopathologie de l'équilibre acide-base en médecine
Chez l'homme, l'alimentation fait entrer massivement des ions H+ dans l'organisme.
Or, les quantités plasmatiques doivent être très faibles pour être compatibles avec la vie, ce qui nécessite une régulation fine par les systèmes tampons acidobasiques.
Le principal tampon est le couple acide carbonique (H2CO3) / bicarbonate (HCO3-) :
H+ + HCO3- ⇔ H2CO3 ⇔ CO2 + H2O
Ce système tampon est dit "ouvert" car l'acide généré est éliminé par la respiratoire et que le bicarbonate est régénéré par le rein.
Le pH sanguin est calculé grâce à l'équation d'Henderson-Hasselbach :
pH = 6,1 + log ([HCO3-] / [H2CO3])
= 6,1 + log ([HCO3-] / 0,03 pCO2)
On constate que le pH sanguin varie lorsque le rapport entre la pCO2 et HCO3- est modifié, c'est-à-dire en pratique lors d'une des situations suivantes :
- Modification primitive des bicarbonates : alcalose ou acidose métabolique
- Modification primitive de la pCO2 : alcalose ou acidose respiratoire
Principales sources d'acide
Dans l'organisme, les acides sont issus de 2 principales sources :
- Acides volatifs : issus du métabolisme cellulaire des glucides et des lipides, générant, en présence de dioxygène (O2), de l'eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2). Le CO2 est directement éliminé par la respiration, sans modifier l'équilibre acidobasique (en situation physiologique).
Une acidose respiratoire peut survenir en cas de ventilation inefficace, entraînant un défaut d'élimination du CO2. - Acides fixes : issus du métabolisme des protéines (H2SO4 pour les acides aminés souffrés, HCl pour la lysine et H2PO4 pour les nucléoprotéines).
Cette charge acide est tamponnée avant d'être éliminée par les reins (en situation physiologique).
Une acidose métabolique peut survenir en cas de défaut d'élimination rénale.
Rôle du poumon
Grâce à la respiration, les poumons permettent d'excréter le gaz carbonique (CO2) et jouent donc un rôle primordial dans la régulation de la pCO2 :
- Une hypoventilation alvéolaire sera responsable d'un défaut d'élimination du CO2, entraînant une acidose respiratoire
- Une hyperventilation alvéolaire sera responsable d'un excès d'élimination du CO2, entraînant une alcalose respiratoire.
En situation physiologique, la régulation de la ventilation pulmonaire dépend de la pO2, de la pCO2 et du pH du sang artériel, grâce à la mise en jeu de mécanismes réflexes impliquant des chémorécepteurs (aortiques, carotidiens et centraux) et les centres neurologiques de la respiration (tronc cérébral).
Rôle du rein
En situation physiologique, les reins permettent également de régulier le pH via 2 mécanismes :
- La partie proximale des tubules rénaux permettent de réabsorber les bicarbonates (HCO3-) filtrés dans les urines.
Une altération de cette fonction peut conduire à une acidose métabolique. - Les canaux collecteurs (partie distale des néphrons) permettent d'excréter la charge acide fixe, ce qui est équivalent à régénérer les bicarbonates consommés.
Une altération de cette fonction peut conduire à une acidose métabolique.
Remarque : en cas d'acidose respiratoire chronique, la compensation rénale induit une augmentation de la génération de bicarbonate et donc une augmentation du taux de bicarbonate.
Gazométrie artérielle : indications et interprétation
En cas de situation faisant suspecter un trouble acidobasique, il faut réaliser une gazométrie artérielle :
- Pathologies respiratoires : insuffisance respiratoire hypoxémique ou hypercanique, aigüe ou chronique
- Pathologies métaboliques : acidocétose (diabétique), insuffisance rénale aigüe sévère, intoxication médicamenteuse, états de choc, etc.
- Pathologies neurologiques : coma hypercapnique, etc.
Le tableau ci-dessous représente les valeurs normales :
| pH | pO2 (mmHg) | pCO2 (mmHg) | Bicarbonates (mmol/l) | |
|---|---|---|---|---|
| Artériel | 7,38 - 7,42 | 80 - 100 | 36 - 44 | 22 - 26 |
| Veineux | 7,32 - 7,38 | 30 - 50 | 42 - 50 | 23 - 27 |
L'interprétation d'une gazométrie se décompense en 3 temps :
- Déterminer s'il existe une acidémie ou une alcalémie
- Déterminer si l'anomalie primitive est métabolique ou respiratoire
- Evaluer les mécanismes compensateurs
1. Acidémie ou alcalémie ?
On parle de :
- Acidémie (ou acidose décompensée) si pH(artériel) < 7,38 ou pH(veineux) < 7,32.
- Alcalémie (ou alcalose décompensée) si pH(artériel) > 7,42 ou pH(veineux) > 7,38
Attention : une anomalie du pH n'est pas nécessaire pour diagnostic un trouble acidobasique.
Par exemple, un pH normal avec une bicarbonatémie basse peut correspondre à une acidose métabolique associée à une alcalose respiratoire.
2. Métabolique ou respiratoire ?
Pour savoir s'il s'agit d'une cause métabolique ou respiratoire, il suffit de regarder l'anomalie "primitive" :
- Anomalies primitives de la pCO2 : acidose (pCO2 élevée) ou alcalose (pCO2 basse) dites "respiratoires"
- Anomalies primitives des bicarbonates : acidose (HCO3- abaissés) ou alcalose (HCO3-augmentés) dites "métaboliques"
3. Réponses compensatrices ?
L'évaluation des mécanismes compensateurs dépend des 4 situations possibles :
- Acidose métabolique (baisse primitive des HCO3-) : hyperventilation compensatrice pour diminuer la pCO2 ?
- Acidose respiratoire chronique (augmentation primitve de la pCO2 depuis au moins 24-48 heures) : génération compensatrice de bicarbonates par les rein ?
- Alcalose métabolique (augmentation primitive des bicarbonates) : hypoventilation compensatrice pour augmenter la pCO2 ?
- Alcalose respiratoire (diminution primitive de la pCO2) : diminution compensatrice des bicarbonates ?
| pH | pCO2 | Bicarbonates | |
|---|---|---|---|
| Acidose métabolique | Bas | Bas | Bas |
| Alcalose métabolique | Haut | Haut | Haut |
| Acidose respiratoire | Bas | Haut | Haut |
| Alcalose respiratoire | Haut | Bas | Bas |
Raisonner devant une acidose métabolique
Le raisonnement devant une acidose métabolique doit comprendre les étapes suivantes :
- Calculer la pCO2 attendue
- Déterminer le trou anionique plasmatique
1. Calculer la pCO2 attendue
Pour calculer la pCO2 attendue , on peut utiliser la formule suivante :
pCO2(attendue) = 1,5 * [HCO3-] + 8 (+/- 2) mmHg
Cette valeur permet de déterminer s'il s'agit d'une acidose métabolique :
- Simple : pCO2 = pCO2(attendue)
- Mixte : pCO2 < pCO2(attendue)
- Complexe : pCO2 < pCO2(attendue)
2. Calculer le trou anionique plasmatique
Pour calculer le trou anionique plasmatique, on peut utiliser la formule suivante :
TA = [Na+] + [K+] - [Cl-] - [HCO3-] = 16 (+/- 4) mmol/l
Pour un trou anionique plasmatique normal
En cas de trou anionique plasmatique normal : la baisse des bicarbonates est compensée par une augmentation proportionnelle du Cl- (anion dosé) dans le sang : on parle d'acidose métabolique hyperchlorémique.
La principale forme d'élimination rénales des protons (H+) est l'ion ammonium (NH4+).
Cet ion est indosable mais son reflet inverse peut être estimé dans les urines par le calcul du trou anionique urinaire (TAU), via la formule suivante :
TAU = UNa+ + UK+ - UCl-
Physiologiquement, le trou anionique urinaire est discrètement positif.
En situation d'acidose métabolique hyperchlorémique, on l'interprète de la manière suivante :
- TAU < 0 : la concentration de NH4+ urinaire est élevée, signant une réponse rénale adaptée.
Il faut alors chercher une cause extrarénale : perte digestive de bicarbonates (diarrhées, iléostomie, etc.). - TAU > 0 : la concentration de NH4+ urinaire est basse, signant une réponse rénale adaptée.
Il faut suspecter une origine tubulaire rénale à l'acidose.- Atteintes proximales : perte de HCO3- par défaut de réabsorption tubulaire
Signes associés : syndrome de Fanconi, ostéomalacie
Causes : myélome, cystinose, médicamenteuses (acétazolamide, ifosfamide, ténofovir)
Kaliémie : basse
pH urinaire : variable (< 5,5 à l'état stable) - Atteintes distales : défaut d'acidification distale
Signes associés : néphrocalcinose, ostéomalacie, lithiase
Causes : syndrome de Gougerot-Sjögren, lupus, hypercalciurie, drépanocytose, médicament (amphotéricine B)
Kaliémie : basse
pH urinaire : > 5,5 - Atteintes distales avec hyperkaliémie : défaut de production de NH4+ et hypoaldostéronisme
Signes associés : signes d'insuffisance minéralocorticoïdes
Causes : uropathies obstructives, hyporéninisme et hypoaldostéronisme (diabète), médicaments (IEC/ARA2, AINS, spironolactone, amiloride, insuffisance surrénalienne, anticalcineurines, triméthoprime, etc.)
Kaliémie : élevée
pH urinaire : < 5,5
- Atteintes proximales : perte de HCO3- par défaut de réabsorption tubulaire
Pour un trou anionique augmenté
En cas de trou anionique augmenté : la baisse des bicarbonates est remplacée par un anion indosé.
Il faut alors s'orienter vers :
- Acidose lactique : états de choc, intoxication aux biguanides, etc.
- Acidocétose : diabétique, alcoolique, de jeûne, etc.
- Insuffisance rénale sévère (aigüe ou chronique) : accumulation d'acides organiques
- Intoxication par un acide exogène : salicylate, éthylène glycol, méthanol, etc.
Raisonner devant une acidose respiratoire
Il est primordial de discerner 2 grands cadres nosologiques :
- Les hypoventilations alvéolaires d'origine pulmonaire :
- Bronchopneumopathie chronique obstructive sévère
- Emphysème pulmonaire sévère
- Réduction parenchymateuse (résection chirurgicale, lésions étendues, etc.)
- Penumopathies inflammatoires (lupus, polymyosite, etc.)
- Les autres, comprenant :
- Défaillances du contrôle ventilatoire :
- Dysfonction cérébrale : infections (encéphalite), traumatismes, tumeurs, accident vasculaire cérébral du tronc cérébral (AVC), sédatifs, etc.
- Dysfonction des centres respiratoires :
- Perte de contrôle : syndrome d'apnée du sommeil de type central, hypothyroïdie, alcalose métabolique, sédatifs, etc.
- Léions des voies afférentes / efférentes : traumatisme médullaire cervical (> C5), myélite transverse, sclérose en plaque (SEP), maladie de Parkinson
- Dysfonction des récepteurs périphériques : endartériectomie carotidienne bilatérale, neuropathie diabétique, etc.
- Défaillances de la pompe ventilatoire :
- Altération de la fonction neuromusculaire :
- Atteinte de la corne antérieure de la moelle : poliomyélite, sclérose latérale amyotrophique (SLA), etc.
- Atteinte des nerfs périphériques : syndrome de Guillan-Barré, etc.
- Atteinte de la jonction neuromusculaire : myasthénie, botulisme, etc.
- Atteinte des muscles respiratoires (diaphragme) : myopathies / myosites inflammatoires, troubles métaboliques (hypokaliémie, hypophosphatémie, hypermagnésémie)
- Pathologie de la cage thoracique : cyphoscoliose, épanchement pleural (liquidien ou gazeux), obésité
- Altération de la fonction neuromusculaire :
- Défaillances du contrôle ventilatoire :
Traitement des troubles acido-basiques
Pour traiter les troubles acidobasiques aigüs : il faut traiter la cause
En d'acidose respiratoire : on peut améliorer l'élimination du CO2 par la ventilation non invasive (VNI) ou invasive (après intubation trachéale)
En cas d'acidose métabolique aigüe :
- Alcaliniser le sang par une perfusion de bicarbonate de sodium :
- Indispensable dans les acidoses métaboliques hyperchlorémiques ou associées à certaines intoxications
- A discuter dans les acidoses lactiques
- Non conseillé dans les acidocétoses : insuline et réhydratation suffisent
- A éviter en cas de surcharge hydrosodée, d'hypokaliémie ou d'hypocalcémie (privilégier la dialyse)
- Epuration extrarénale : en cas d'insuffisance rénale aigüe organique (pour éviter la surcharge hydrosodée liée à la perfusion de bicarbonates de sodium)
En cas d'acidose métabolique chronique : alcalinisation par bicarbonate de sodium per os (1 à 6 g/jour) nécessaire pour maintenir un taux plasmatique > 22 mmol/l, afin d'éviter une fonte musculaire, une déminéralisation osseuse voire un retard de croissance chez l'enfant.